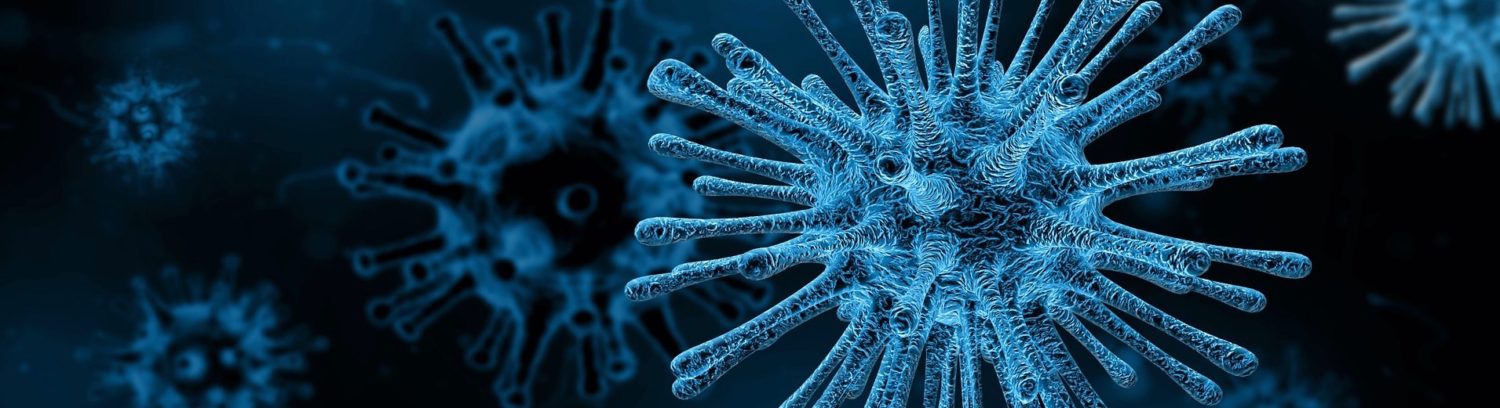Jean de Kervasdoué
Professeur émérite du Cnam, membre de l’Académie des technologies

Avant de pouvoir être prescrite par un médecin à un patient, toute innovation médicale, qu’elle soit diagnostique ou thérapeutique, doit être autorisée à être « mise sur le marché ». Cette première et longue étape ne suffit pas car, pour la très grande majorité des patients, il faut aussi que cette innovation soit remboursable par l’assurance maladie ; elle doit donc être inscrite à une nomenclature et obtenir un tarif. Le bien-fondé de cette procédure ne se discute pas : il faut en effet qu’une « innovation » en soit vraiment une et qu’elle améliore l’arsenal thérapeutique. Toutefois, la procédure française est longue, lente, bureaucratique et, paradoxalement, dessert les entreprises nationales. Quant au rationnement, c’est le mot qui convient et qui se dissimule derrière ce que l’on appelle pudiquement « régulation ». Or il s’agit bien d’une limitation autoritaire de l’accès à un produit ou à un service par des procédures de restriction de l’offre et le choix d’un niveau de remboursement par l’élaboration d’un tarif. Un tarif n’est pas un prix. Contrairement au prix, il ne signale en rien les préférences du consommateur, l’importance de la demande et l’éventuelle rareté de l’offre.
Dans le domaine de la santé, pratiquement tout est rationné : hôpitaux, clinique, médicaments, tarifs et cela s’appelle : autorisation, numerus clausus, inscription à la nomenclature… derrière toutes ces politiques, derrière tous ces mots se trouvent des mécanismes de régulation qui, tous, rationnent. Le plus souvent conçus au cours des décennies passées, ils structurent le système de santé et, à l’évidence, pour beaucoup d’entre eux, sont obsolètes, pas ou mal gérés. Les lignes qui suivent ne vont que très succinctement traiter du rationnement de l’innovation. Le lecteur intéressé pourra se reporter à l’ouvrage que nous venons de publier.[1]
La médecine s’est transformée grâce à l’innovation
Dans le domaine des soins médicaux, l’innovation joue un rôle analogue à celui des autres secteurs et se traduit notamment par une amélioration sensible de la productivité, mais aussi, en augmentant le champ du possible, les innovations médicales permettent de mieux diagnostiquer, de mieux soigner des maladies jusque-là incurables et, simultanément, accroissent les dépenses de soins.
L’innovation en santé est un sujet positif et fédérateur. Il ne suscite pas les mêmes craintes qu’en agronomie où la population redoute l’usage des OGM comme celui des produits de synthèse pour améliorer la santé des plantes. Ainsi, les Français soutiennent très généreusement les initiatives du Téléthon dont l’objectif est, notamment, de permettre de réaliser des manipulations génétiques pour soigner les patients porteurs d’allèles récessifs aux effets pathogènes. A juste titre, ils croient au progrès dans le domaine sanitaire et semblent être disposés à prendre des risques quand il s’agit de leur santé même si des voix plus réservées se font sentir, en matière de vaccins par exemple.
« Innovation », le sens de ce mot, nous venons de le voir, est emporté par sa connotation positive. En lui sont placés tant d’espoirs : soigner les pathologies jusqu’ici incurables, abolir les conflits organisationnels, réduire le déficit de l’assurance maladie, créer de l’emploi, permettre le développement « durable »… Innovez ! Peut-être, mais quand et pourquoi ? Toutes les innovations ne sont pas nécessairement des progrès.
Certaines de ces inventions – pas toutes – permettent de prendre des brevets et, ce faisant, protègent l’idée de l’inventeur durant une période donnée (20 ans le plus souvent) en lui garantissant un monopole. L’économie libérale non seulement reconnaît mais favorise ce type de monopole et intervient quand il est menacé. Le procès de Pretoria intenté par trente entreprises pharmaceutiques contre le Gouvernement sud-africain pour avoir autorisé la copie des constituants de la trithérapie pour les patients porteurs du virus du sida souligne l’importance donnée à la propriété intellectuelle, y compris quand les fondements éthiques des procès pour plagiat illégal sont pour le moins discutables.
Toute innovation modifie les structures sociales
Quand une innovation apparaît, quelle que soit la source, ces acteurs vont immédiatement se poser la question de savoir en quoi cette chose, ce concept, ce système va ou non modifier leur pouvoir. Oui, y penser toujours, ne le dire jamais, les organisations, et notamment les hôpitaux, sont aussi des systèmes de pouvoir où personne n’a envie de se tirer une balle dans le pied sous prétexte que l’innovation pourrait être globalement bénéfique.
Ainsi, l’hospitalisation de jour n’a que des avantages pour le patient (les établissements hospitaliers sont des institutions essentielles mais dangereuses et moins on y séjourne, mieux on se porte) comme pour la collectivité (le coût est environ la moitié d’une hospitalisation traditionnelle). Pourtant, depuis plus de trente ans, elle diffuse très lentement à l’hôpital public. Les raisons sont simples. En France, les directeurs n’interviennent pas dans l’organisation des soins médicaux. Chaque « service », « pôle », « département » est indépendant. Personne n’est donc capable d’imposer une organisation contraignante à l’anesthésiste, au chirurgien, aux labos, à la radio, aux soignants qui ne gagneront pas un centime de plus pour modifier les habitudes qui veulent que l’on opère quand on veut, le matin, en commençant par les cas graves… A moins que quelqu’un ne s’en saisisse, prenne le pouvoir, modifie l’organisation et règne sur ce nouveau territoire… en attendant la prochaine innovation ou le départ de l’innovateur.
Si le dossier médical partagé n’a pas réussi, là aussi la raison est simple. Quand une procédure quelconque (contribuer à remplir un dossier informatisé dans ce cas), ne fait pas partie du contrat de travail et qu’aucune sanction ne suit le non-respect de la procédure, elle est inefficace et, un jour ou l’autre, abandonnée. Autrement dit, aussi, quand il n’y a pas de pouvoir, il n’y a pas d’innovation diffusée.
Les innovations médicales bouleversent ou confortent le pouvoir à l’hôpital des uns ou des autres, comme il peut conforter celui d’une profession. Donc c’est l’hôpital, ses règles, ses structures de pouvoir qui vont permettre que certaines innovations soient rapidement adoptées, alors que d’autres seront superbement ignorées quoique, peut-être, plus utiles. Il en est de même des professions libérales.
Non seulement une innovation trouve, ou ne trouve pas, sa place dans un système social donné, mais l’innovation peut être tout ou partie du système lui-même. Tout d’abord, il est rare qu’une innovation seule bouleverse une institution, mais cela arrive ; ainsi le traitement de la tuberculose par antibiotique a conduit en une décennie à la fermeture des sanatoriums. Le plus souvent, une innovation prend sa place dans un système technique et contribue à son évolution, jusqu’à, parfois, le bouleverser. Les innovations évoluent en grappe (clusters). Ainsi, à l’échelon mondial, la puissance toujours croissante des calculateurs a permis le développement de la génomique, mais il a fallu aussi des progrès dans les nanomatériaux, dans la protéinomique, pour que la neurobiologie, entre autres, se développe et apparaisse la médecine dite « personnalisée »… La science des uns est la technique des autres. Les découvertes d’une discipline (le microscope par exemple) ouvrent à une autre discipline (la biologie), un autre monde, et est source de découvertes. Aujourd’hui, le facteur déterminant, le primum movens, est l’informatique grâce à laquelle, notamment, le séquençage du génome humain a été possible.
Une incapacité à soutenir les inventions et les innovations médicales nées en France
Tous les grands pays industrialisés défendent leurs industriels et privilégient donc les inventions et les innovations nationales. Certes, elles ne peuvent pas toujours le faire, soit parce qu’il n’y a pas d’industrie nationale, soit que le produit inventé à l’étranger est particulièrement innovant, mais pour beaucoup – pratiquement tous –, c’est la réalité pratique, même si, juridiquement cela est interdit, en principe, notamment par la réglementation européenne ! Certes, certains pays sont moins brutaux, plus subtils que d’autres, certes – en apparence – les règles sont respectées, mais de fait, les étrangers ayant des produits de qualité « n’ont pas de chance » dans la plupart des appels d’offre et ces « manques de chance » répétés se reproduisent avec une constance telle qu’elle ne doit rien au hasard. La France est, de ce point de vue, plus « exemplaire [2] » que ses voisins ! Il n’est pas facile pour un concurrent de Siemens de vendre un produit quelconque dans un hôpital allemand, car il y a un représentant de cette très grande entreprise au conseil d’administration de plus de 300 établissements hospitaliers. Outre-Rhin encore, une grande entreprise française de matériaux utilisés dans les hôpitaux était toujours seconde dans les appels d’offre, jusqu’à ce qu’elle achète une entreprise allemande. Aux Etats-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) regarde avec une attention très particulière – et très longue – les innovations étrangères. Au Japon, le soutien est encore plus manifeste, car les hôpitaux surpayent les produits japonais pour qu’ils dégagent une marge et exportent à un coût très inférieur. Aux Etats-Unis de nouveau, beaucoup de recherches, y compris dans le domaine de la santé, sont financées par le ministère de la Défense… Ce patriotisme d’ailleurs est partout, sauf en France [3], culturel, naturel, donc automatique. Ainsi, pour participer au développement d’une startup prometteuse française dans le domaine des vaccins, les éventuels investisseurs étrangers posent comme préalable le transfert ou, a minima, la création d’une filiale dans leur pays et ce, en dehors de tout impératif réglementaire.
Il est très difficile pour un acheteur public de décoder la stratégie commerciale d’une entreprise et il n’est pas certain que cela soit son rôle ; cependant il est fréquent que les prix bas soudainement proposés pour tels ou tels produits par une entreprise à un instant donné ne soient que la manière de sortir du marché un concurrent aux reins financiers moins solides, le plus souvent une petite entreprise française. A terme, la faillite du concurrent innovant permettra à ceux restés en place d’augmenter leurs prix, cette « mauvaise » période passée.
Pour les produits remboursés par l’assurance maladie (médicaments, prothèses, appareils d’imagerie, de radiothérapie et autres produits médicaux) se pose aussi la question du tarif et, tout aussi cruciale, la question de la vitesse d’analyse du dossier. Là encore, le plus souvent, l’instruction est longue, la procédure mal cernée et peu claire et, contrairement à ce qui se passe à l’étranger mais conformément à la loi, les entreprises françaises ne sont guère favorisées.
Soulignons encore que toutes ces procédures sont justifiées car un malade ne peut pas juger seul de la qualité d’un produit et, le cas échéant, se prémunir de ses éventuels dangers. L’assurance maladie ne peut pas payer à guichet ouvert même si les industriels souhaitent bénéficier d’une liberté des prix et de la certitude de jouir d’un marché solvable. Néanmoins, toutes les innovations médicales sont triplement rationnées : à l’entrée sur le marché, pour le niveau de remboursement par l’assurance maladie et le montant du tarif.
Un niveau de preuve élastique
Quel niveau de preuve, quelle « évaluation » compte tenu des caractéristiques du produit, de ses bénéfices potentiels, de son coût, sont-ils nécessaires pour inscrire un produit à la nomenclature et notamment quand l’expérimentation n’est pas possible ? Quand les patients ne sont pas affectés de manière aléatoire à un groupe de contrôle pour tester le bénéfice d’une technologie, on parle de « quasi-expérience ». Ces méthodes sont très utilisées en politique de santé pour étudier, par exemple, l’efficacité des mesures pour limiter le tabagisme, mais c’est aussi le cas de toutes les études de cohorte, des panels, des études « avant-après ».
La simplicité n’est encore qu’apparente, le niveau de preuve, variable et, derrière ces procédures, se cache un rapport de force entre l’Etat et l’entreprise. Il peut être en faveur de l’entreprise si sa découverte est majeure et sa base internationale, ou en sa défaveur si l’entreprise est une PME, en général française. Ainsi on voit bien qu’une décision scientifique peut être « utilisée pour réguler un mode de financement » [4] et retarder non seulement l’accès à une innovation, mais l’innovation elle-même. En effet, les règles françaises sont appliquées de telle façon que les rares essais cliniques qui s’y font encore se déplacent vers l’Allemagne ou les Etats-Unis.
Prenons l’exemple de Theraclion, entreprise française. Elle met au point un dispositif médical qui traite les adénofibromes du sein et des nodules thyroïdiens grâce à une machine à ultrasons, l’Echopulse. La Haute Autorité de santé (HAS) est consultée et se déclare enthousiaste, mais va demander de tels niveaux de preuves qu’il va être impossible de répondre car elles sont en l’occurrence inappropriées. En effet, comme il n’y a pas aujourd’hui de traitement techniquement comparable (il s’agit d’ultrasons et les traitements actuels sont médicamenteux), il n’est pas possible de réaliser un essai randomisé en aveugle : les patients seraient capables pour le moins de faire la différence entre avaler un médicament et être exposé à une machine produisant des ultrasons ! L’agence française exige donc une « preuve » impossible quand l’agence américaine compétente, la FDA, impose des critères plus réalistes, répond plus vite et accompagne l’inventeur pour qu’il puisse apporter rapidement l’illustration tangible du bienfait allégué de cette innovation potentiellement importante. Ainsi, deux années après le démarrage de l’étude, la moitié des patients américains ont été traités et pas un seul ne l’est encore en France. En outre, comme en France les critères en matière de conflits d’intérêts sont devenus totalement déraisonnables, les experts en matière d’ultrasons ont tous été écartés par la HAS ! Si bien que David Caumartin, le directeur général des laboratoires Theraclion, déclare : « Politique de risque zéro + absence de compétence + zéro transparence : nous sommes dans une impasse. Il y a un vrai problème de culture face à l’innovation en France. Dans les pays anglo-saxons et en Allemagne, il y a un vrai pragmatisme. Résultat, je ne programme plus de nouvel essai clinique en France, à part le forfait innovation… La situation n’est pas démoralisante. Elle est révoltante. » [5]
Tout cela ne surprend pas. Nous avons dans d’autres ouvrages [6] expliqué pourquoi il en serait ainsi et en quoi la responsabilité civile et pénale des fonctionnaires, comme l’excès de précaution, les conduiraient à ouvrir des parapluies multiples pour n’être responsables de rien par crainte, étant accusés de tout, d’être un jour coupables d’avoir pris un risque. Il faut dire que la classe politique, échaudée par l’affaire du sang contaminé, ne protège pas les experts et hauts fonctionnaires qui doivent prendre ces responsabilités. Remarquons en outre que les réglementations et précautions n’ont pas empêché l’affaire du Mediator, pas plus que le fait que des entreprises mondiales innovantes pèsent de tout leur poids sur les systèmes sociaux des pays occidentaux, jusqu’à les prendre en otage. L’affaire du Solvadi illustre un processus inverse, cette fois au bénéfice de l’entreprise. Il se généralise et montre comment certaines d’entre elles peuvent manipuler les systèmes de protection sociale et, bien entendu, les habitants de la planète. L’accès au marché, la négociation des tarifs mettent en jeu des intérêts considérables.
Une politique de l’innovation asservie au seul équilibre des comptes de l’assurance maladie
Quand on se penche sur plus d’un demi-siècle de politique du médicament, le bilan n’est guère positif. Non seulement la place de l’industrie française recule, mais les dépenses de médicaments dépassent de 12% la moyenne des pays comparables alors que les tarifs sont bas. Il y a deux raisons essentielles à cela. La première est qu’à l’exception du « crédit d’impôt recherche », l’Etat et les directions concernées (Sécurité sociale, Budget) n’ont pas su distinguer, comme l’ont fait leurs équivalents britanniques, l’élaboration d’une politique industrielle favorable aux entreprises du secteur et, par ailleurs, la maîtrise des dépenses de soins médicaux. La seconde raison provient du fait que le rationnement ne concerne que l’entrée sur le marché et les tarifs, pas les volumes. Les médecins français ont jusqu’ici réussi à ce que leurs prescriptions ne soient pas ou peu contrôlées, fussent-elles en dehors des indications définies au moment de l’autorisation de mise sur le marché. En outre si, bien entendu, les industriels font tout pour que leurs médicaments puissent être vendus et remboursés, ils ne font rien pour les sortir de la liste qui les a mis sur le marché quand ils ont été remplacés par des thérapeutiques plus efficaces. Or il existe des médicaments autorisés qui n’ont aucun effet thérapeutique (les médicaments homéopathiques), d’autres qui sont tout aussi inefficaces et plus dangereux (les médicaments prescrits aux patients atteints de la maladie d’Alzheimer), enfin, et c’est le cas le plus général, beaucoup de médicaments sont mal, parce que trop, prescrits. Ainsi, nous estimions de manière conservatrice que l’on pourrait économiser de l’ordre de 3,5 milliards d’euros de dépenses d’assurance maladie si les médicaments étaient prescrits à bon escient [7].
Une révolution sans réforme
La France dispose des mécanismes institutionnels qui permettent au plus grand nombre d’accéder en toute sécurité aux innovations médicales. Il n’y a de rationnement explicite (comme au Royaume-Uni) que dans la gestion de la « liste en sus » de certains médicaments hospitaliers. Faute d’être capable de gérer le bon usage des médicaments, trop ou pas assez prescrits, la puissance publique (Etat et assurance maladie) a surtout joué sur la fixation des tarifs, ce qui est de bonne guerre, et, de manière plus contestable, sur le taux de remboursement par l’assurance maladie. Cette dernière mesure est contestable car le complément de ce que ne rembourse pas l’assurance maladie est pris en charge par des assureurs privés qui couvrent plus de 93% de la population. Autrement dit, l’effet dissuasif est nul. Quant à la baisse de prix, quand elle descend au-dessous de certains seuils, les entreprises cessent d’approvisionner le marché et les ruptures de stock se multiplient.
Il n’y a pas eu de distinction entre une politique industrielle favorable à l’industrie et une politique médicale qui chercherait la juste rémunération des industriels. Cette politique est marquée par la trop large extension du principe de précaution, comme celle des conflits d’intérêts qui conduit au transfert des essais, voire des entreprises vers d’autres pays.
Mais la caractéristique essentielle est l’opacité de ce millefeuille bureaucratique. Il n’est transparent pour personne. Il n’est pas géré, les fonctionnaires qui ont la tutelle des agences sont très peu nombreux. L’Etat manque d’expertise scientifique et technique, ce qui laisse la place à un champ de bataille où rentre beaucoup d’argent et dont sortent certes des innovations mais aussi quelques cadavres industriels, le plus souvent français. L’Etat ne consacre pas suffisamment de temps et d’agent à gérer ce qui est son outil économique essentiel : la conception des actes et le calcul de leur tarif.
Il n’y a aucun texte à changer, seulement la manière de les appliquer, ce qui, à l’évidence, semble quasi impossible.